Le 13 mars 2024, Cédric Ringenbach créateur de l’outil pédagogique de sensibilisation La Fresque du Climat annonce qu’il quitte la présidence de l’association du même nom par une lettre écrite à la communauté reçue par email par plusieurs milliers de personnes. Tout en retraçant son parcours, l’auteur de la fresque indique que « la décision d’adopter une licence d’utilisation ouverte et vertueuse était un pari sur l’intelligence collective et sur la générosité ». Or, précisément, la licence de La Fresque du Climat n’est pas une licence ouverte. Alors que plus d’une centaine de fresques amies utilise cette même licence, s’assimilant à ce vocable d’intelligence collective et de générosité, un point historique et une mise en perspective sur la notion d’objet ouvert s’impose.
Dans le cadre des cours de culture numérique que je donne à mes étudiants du supérieur, la séance sur les logiciels libres ou open-source commence par un mise en contexte historique. Le premier exercice consiste à définir la notion d’objet technique ouvert selon Gilbert Simondon, auteur du livre Du mode d’existence des objets techniques, publié en 1958, ouvrage de référence dans le domaine de la philosophie de la technique.
La notion historique d’objet technique ouvert
Selon Gilbert Simondon, un objet technique ouvert est adaptable, modifiable, améliorable par l’utilisateur. Cette ouverture favorise l’amélioration continue de l’objet, car de nouvelles innovations peuvent être intégrées au fil du temps, limitant ainsi son obsolescence.
Dans son ouvrage Éloge du carburateur, Essai sur le sens et la valeur du travail, le mécanicien américain Matthew B. Crawford expose la difficulté grandissante qu’il éprouve à réparer les motos récentes dont les moteurs ressemblent de plus en plus à des boîtes noires dissimulées derrière des caches, formant un mono bloc impénétrable. Toute la richesse de son métier reposant dans le remplacement des pièces, le réglage et la compréhension fine des interactions en jeu permettant les adaptations spécifiques au problème rencontré. Ainsi, pour Crawford « si la pensée est intimement liée à l’action, alors le tâche de saisir adéquatement le monde sur le plan intellectuel dépend de notre capacité d’intervenir sur ce monde. » En ce sens, le manuel d’entretien d’une moto apporte la possibilité au mécanicien de l’entretenir et de la faire évoluer grâce à son savoir-faire et sa propre intelligence. Dans ce cas, la qualificatif d’objet technique ouvert s’applique.
Objet technique fermé
Par opposition, selon Simondon, l’objet technique fermé, ou concrétisé, est entièrement conçu et validé dès sa sortie d’usine, mais vieillit avec le temps, car il perd son contact avec la réalité contemporaine. Le point crucial ici est de savoir qui a la possibilité technique et le droit légal d’assurer les évolutions nécessaires de l’outil afin qu’il ne devienne pas obsolète dès la fin de sa phase de création et qu’ainsi l’adaptation aux différents contextes d’utilisation reste accessible à ceux qui en éprouvent le besoin.

Pour Crawford, « dans le meilleur des cas, les activités de construction et/ou de réparation sont inséparables d’une communauté d’usager. » Selon Yves Deforge, dans la post-face de Du mode d’existence des objets techniques, « nous pouvons appeler ‘systèmes clos’ les systèmes fortement structurés qui se multiplient et prolifèrent en s’interconnectant, ne laissant plus que d’étroits espaces interstitiels à la liberté de créer et de procréer, de tester et de contester ».
Les logiciels libres en informatique
Dans cette filiation idéologique, le mouvement du logiciel libre initié par Richard Stallman au milieu des années 1980, définit des principes et des licences garantissant, l’utilisation, l’étude, la modification et la duplication par autrui en vue de sa diffusion des logiciels libres.
En pratique, toutes les personnes en ayant les capacités techniques, peuvent télécharger un logiciel libre, le modifier et le revendre sans besoin de demander d’autorisation ni de reverser de droits d’auteurs.
Creative Commons, la libération des œuvres créatives
En 2001, Lawrence Lessig, un juriste américain, crée, avec d’autres, en s’inspirant des droits appliqués aux logiciels libres, les licences Creative Commons afin d’encourager de manière simple et licite la circulation des œuvres, l’échange et la créativité.
Ces licences s’accompagnent d’options applicables ou non par l’auteur, restreignant les droits d’utilisation de l’œuvre.
- Le suffixe NC pour No Commercial – pas d’exploitation commerciale – règle le droit d’usufruit,
- Le suffixe ND pour No Derivative – pas de modification – contraint la gestion, donc l’évolution de l’œuvre.
Concrètement, pour en revenir à La Fresque du Climat et l’essentiel des fresques amies, la licence CC BY NC ND appliquée à ces outils, n’autorise pas la libre modification et revente. Cette licence, bien que définie officiellement par l’association Creative Commons, n’est pas une licence ouverte au sens de Simondon, Crawford ou libre pour Stallman. Elle ferme la possibilité à quiconque d’adapter l’outil en réservant le droit exclusif de son évolution à son ou à ses auteurs.
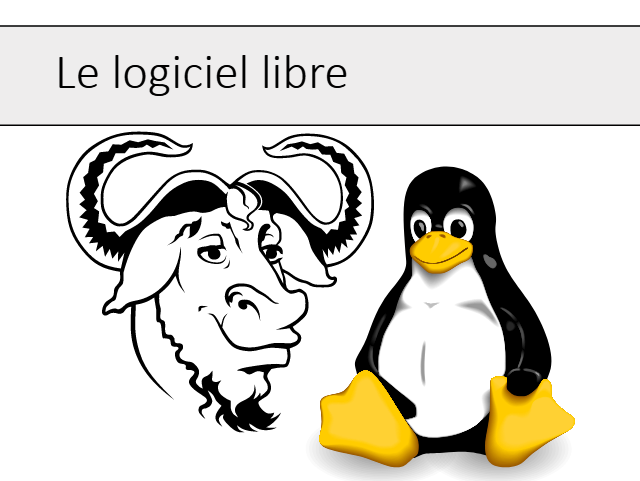
Selon le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur La mise à disposition ouverte des œuvres de l’esprit paru en juin 2007, les « licences ouvertes paraissent particulièrement bien adaptées à des œuvres évolutives, ou cumulatives (la création finale dépend des créations précédentes) et associant le travail de contributeurs différents ». Clairement, cette vision ne s’applique pas à la licence choisie par le créateur de La Fresque du Climat.
Inverser notre vision de la propriété
Selon les termes de Pierre Crétois dans son article Pour une copossession du monde paru dans le numéro Pour sortir de l’impasse du magazine Socialter « nul ne peut prétendre avoir tous les droits sur ce qui lui appartient : il peut seulement avoir des droits précis, compatibles avec les droits revendicables par les autres. Cela a des implications importantes : la propriété n’est, en réalité, pas d’abord un droit que l’être humain exerce sur les choses, mais c’est un droit qu’il exerce sur les autres, c’est une façon de réguler les relations sociales qui se déploient par et à travers les choses matérielles. » Pour les fresques, l’enjeu est de savoir qui a le droit d’ajouter des cartes, d’en modifier, et de proposer une animation nouvelle incluant ces modifications.
la propriété n’est, en réalité, pas d’abord un droit que l’être humain exerce sur les choses, mais c’est un droit qu’il exerce sur les autres
S’agissant d’un outil s’appelant La Fresque du Climat mais ne reprenant que partiellement les rapports du GIEC en ne sélectionnant que les propos compatibles avec la vente de prestations auprès des patrons du CAC 40, la volonté d’amender l’existant paraît légitime, si l’on considère qu’aussi bien le climat planétaire que les rapports du GIEC constituent des ressources à gérer en commun par l’humanité.
Pour rappel, selon Henri Desbois dans Le droit d’auteur en France cité par le Rapport de la mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur les œuvres transformatives, « les œuvres de l’esprit sont celles qui « procèdent d’une activité créatrice », celle-ci réalisant « une production originale, dans laquelle se reflète et s’exprime la personnalité de l’écrivain ou de l’artiste« . Il y a donc un parti pris dans toute œuvre créative, un parti pris qui par définition peut ne pas être partagé et n’a rien de soit-disant irréfutable car basé sur des rapports scientifiques.
L’auteur du jeu de cartes a décidé de conserver pour lui la gestion de l’outil qu’il a créé. Il m’a déjà été rétorqué qu’il suffisait de recréer la même chose à partir de zéro. Rien n’assure juridiquement que le premier qui crée une « toile du GIEC » ne s’expose pas à un procès du créateur de La Fresque du Climat. Cette crainte serait infondée avec une licence Creative Commons sans l’attribut No Derivative. Cet attribut sert précisément à empêcher une réinterprétation de l’œuvre sans l’accord de son auteur.
Pierre Crétois d’ajouter, dans le même article précédemment cité, « au lieu de partir du propre pour penser le commun, il faudrait faire l’inverse. Il s’agirait de partir du commun, non pour nier le propre, mais pour en définir l’extension et les limites équitables« .
Le principe révolutionnaire du commun
S’il ne s’agissait que d’une question de sémantique et de droit, cela ne justifierait pas que j’en écrive un article et que vous preniez le temps de le lire. Mais il me semble que, comme l’écrivent Pierre Dardot et Christian Laval dans l’ouvrage Commun, essai sur la révolution au XXIème, « au cœur du projet révolutionnaire tel que nous le comprenons, il y a le principe du commun » et « chaque commun doit être institué par une pratique qui ouvre un certain espace en définissant les règles de son fonctionnement. Cette institution doit être continuée au delà de l’acte par lequel un commun est créé […] La praxis instituante est donc une pratique de gouvernement des communs par les collectifs qui les font vivre. »
une pratique de gouvernement des communs par les collectifs qui les font vivre
Vue l’importance qu’a prise cette dynamique constituée de plus de 72 000 animatrices et animateurs et l’influence que son modèle de développement exerce sur les différentes communautés formées autour de dizaines de fresques amies, ce qui se passe au sein de La Fresque du Climat constitue une praxis instituante qu’il convient d’analyser et de critiquer si besoin.
En effet, bien que l’association bénéficie de cette image de création de commun, la licence et le système de rente choisis ne se conforment pas à la définition du commun au potentiel réellement transformateur exposée par la prix Nobel de l’économie Elinor Ostrom, ni aux recherches passionnantes se poursuivant sur le sujet.
Elinor Ostrom et les communs
Lors de son discours de réception du prix Nobel de l’économie en 2009, Elinor Ostrom synthétise son travail en retraçant l’histoire des notions de biens privés, biens publics, biens de club ou à péage et réservoirs communs de ressources, contrecarrant la fameuse tragédie des communs de Garrett Hardin.

Avec Poteete et Janssen, Elinor Ostrom définit les principes de gouvernance d’un bien commun, rappelés dans son discours de Stockholm, comme les « attributs affectant le plus le niveau de coopération atteint par les participants lors d’un dilemme social (incluant les dilemmes de biens publics et ceux des réservoirs communs de ressources) ». Ainsi, comme l’écrit Édouard Jourdain dans l’article Au-delà du marché et de l’État ? Elinor Ostrom et l’institution des communs paru dans le numéro 61 En commun ! de la revue du Mauss, « les communs sont beaucoup plus que des biens partagés : ce sont des institutions qui donnent la capacité à des personnes de gouverner collectivement des biens ou des services ».
Degrés et échelle de communalité
Selon Édouard Jourdain, dans son ouvrage Les nouveaux biens communs , « le degré de communalité d’un bien ou d’une ressource dépend de deux critères, l’un dit d’intérêt commun et l’autre dit d’inclusivité. Le premier se rapporte à l’utilité collective du bien ou de la ressource (usage commun, impératif de préservation, gestion commune); le second se rapporte à la possibilité pour chacun d’en revendiquer le droit d’usage, de gestion ou de contrôle. Cette échelle de communalité s’attaque donc au caractère par trop exclusif des droits associés à la propriété et s’applique indifféremment, de manière transversale, aussi bien à la propriété privée que publique ». Le degré de communalité d’une ressource partagée ou d’une œuvre de l’esprit comme un jeu de carte de sensibilisation dépend ainsi de l’intérêt que lui porte une communauté et des droits d’usage, de gestion et de contrôle dont elle dispose sur cette ressource.
Actuellement, d’après la description de la situation par Cédric Ringenbach dans sa lettre adressée à la communauté, l’association de La Fresque du Climat détient, comme tout le monde, le droit d’accès non commercial, et négocie régulièrement avec le créateur, moyennant rétribution financière, le droit d’usufruit, commercial. Le droit de gestion, si l’on entend par là le droit de modification sur une ressource évolutive, reste l’exclusive propriété de son créateur. Ainsi si les 72 000 animateurs de La Fresque du Climat délibèrent pour décider collectivement qu’il manque une carte au jeu, ils peuvent être légalement bloqués par une seule personne.
D’après Dardot et Laval « La primauté du commun n’impliquant donc pas la suppression de la propriété privée, à fortiori n’impose-t-elle pas la suppression du marché. Elle impose par contre leur subordination au commun et, en ce sens, la limitation du droit de propriété et du marché, non pas seulement en soustrayant certaines choses à l’échange commercial pour les réserver à l’usage commun, mais en supprimant le droit d’abuser (jus abutendi) par lequel une chose est entièrement livrée au bon vouloir égoïste de son propriétaire. […] Comme principe, le commun définit une norme d’inappropriabilité. Il impose en effet de refonder toutes les relations sociales à partir de cette norme : l’inappropriable n’est pas ce que l’on ne peut s’approprier, c’est à dire ce dont l’appropriation est impossible en fait, mais ce que l’on ne doit pas s’approprier , c’est à dire ce qu’il n’est pas permis de s’approprier parce qu’il doit être réservé pour l’usage commun. Il revient donc à la praxis instituante de déterminer ce qui est inappropriable ».
Les outils pédagogique comme La Fresque du Climat gagneraient-ils à être inappropriables, c’est à dire libérés de l’interdiction de s’en inspirer pour créer des variantes ? J’en ai l’intuition. Et ce serait une magnifique démonstration de la puissance des communs, sans doute à la hauteur du formidable développement de Wikipédia. Alors, on essaye ?

